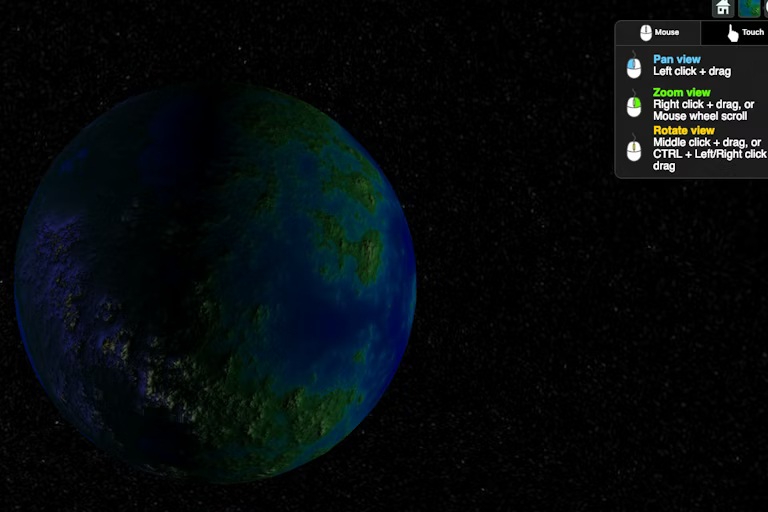La Terre est-elle le berceau de l’humanité ? Quelques réponses en science-fiction

L’image de la Terre « berceau » de l’humanité a longtemps nourri l’imaginaire de la colonisation spatiale, de la science-fiction et l’esprit des entrepreneurs de conquêtes spatiales. Elle est aujourd’hui remise en question par une multitude d’œuvres de science-fiction, au cinéma comme en littérature.
« La Terre est le berceau de l’humanité, mais nul n’est destiné à rester dans son berceau tout au long de sa vie. » Cette phrase du père de l’astronautique moderne Constantin Tsiolkovski (1857-1935) a marqué durablement l’astroculture sous toutes ses formes, dans sa Russie natale comme en Occident. Elon Musk, les personnages du film Interstellar (Christopher Nolan, 2014) ou bien ceux du roman Aurora (Kim Stanley Robinson, 2015) citent aisément la métaphore du « berceau » pour justifier la colonisation spatiale, ou au contraire la discuter.
De ses origines jusqu’à son assimilation et son questionnement par la science-fiction (SF) contemporaine, plongeons dans les méandres d’une métaphore qui structure puissamment les imaginaires de l’exploration spatiale.
Une citation aux origines floues devenue un lieu commun
La métaphore du « berceau » est en réalité un amalgame de deux citations. Tsiolkovski était un des fers de lance du cosmisme russe, un courant philosophique, scientifique et spirituel apparu à la fin du XIXe siècle. Selon lui, la destinée humaine est de quitter la Terre pour « contrôler entièrement le système solaire. » Il exprime cette idée dans une lettre, datant de 1911, adressée à un ami ingénieur. Cette correspondance est la source la plus fréquemment utilisée pour référencer la métaphore du berceau, pourtant le mot « berceau » (« cradle » en anglais, « колыбель » en russe) n’y est pas utilisé.
L’image du berceau apparaît en 1912, en conclusion d’un de ses articles pour un magazine d’aéronautique, dans une phrase qui détermine la structure de la métaphore :
« Notre planète est le berceau de la raison, mais personne ne peut vivre éternellement dans un berceau. »
Différents passages de Tsiolkovski semblent donc avoir été amalgamés en une citation dont l’origine exacte fait l’objet de confusions et dont la traduction opère un changement de sens : la « planète » devient la Terre et la « la raison » devient l’humanité. Cette citation controuvée s’est ainsi transformée au fil du temps en un puissant lieu commun souvent mobilisé pour soutenir la colonisation spatiale.
Un lieu commun débattu en science-fiction
Tsiolkovski avait une riche activité d’écrivain-vulgarisateur. Plusieurs de ses nouvelles racontent le futur spatial de l’humanité en décrivant des habitats spatiaux ou l’expérience sensorielle et émotionnelle de la vie en impesanteur. Inspiré par Jules Verne et l’astronome Camille Flammarion, il a contribué comme eux à poser les fondements de ce qu’on nommera plus tard la science-fiction.
La SF est née à la fin des années 1920, dans les pulps magazines américains. Seuls les textes scientifiques sur l’astronautique de Tsiolkovski sont alors connus au-delà de l’Atlantique. Les idées qu’il développe dans ses récits ont participé à bien des égards à l’élaboration de l’imaginaire science-fictionnel, mais sa métaphore reste finalement son héritage le plus perceptible dans le genre.
L’auteur de SF britannique Brian Aldiss cite Tsiolkovski dans son roman Mars Blanche (2001), l’idée du berceau est employée comme un argument en faveur de la colonisation de Mars, puis critiquée par un personnage qui la range parmi les lieux communs empêchant de renouveler l’imaginaire de l’exploration spatiale.
Kim Stanley Robinson discute également de la sédimentation de la métaphore dans son roman Aurora (2015). L’auteur états-unien affirme avoir voulu « tuer cette idée que l’humanité est vouée à aller dans les étoiles ». Une scène illustre cette intention : lors d’un colloque, les revenants d’une mission de colonisation spatiale se battent avec ceux qui justifient ce projet grâce à l’image du berceau.
Dans ces œuvres, l’usage tel quel de la citation de Tsiolkovski permet le développement d’une double critique : celle de l’image produite par cette métaphore et celle du bien-fondé de la colonisation spatiale. C’est une chose nouvelle dans la SF du XXIe siècle puisqu’avant les années 1990, « être contre l’espace [revenait à] être contre la SF », selon le critique Gary Westfahl.
Un symbole aux enjeux écologiques
L’absence de remise en question de la colonisation spatiale perdure encore dans la SF actuelle. Elle s’observe dans la manière dont la métaphore du berceau se trouve paraphrasée dans certaines œuvres, comme le blockbuster Interstellar (2014). Dans une réplique, le héros du film affirme :
« Ce monde est un trésor […], mais il nous dit que l’on doit le quitter maintenant. L’humanité est née sur Terre, on n’a jamais dit qu’elle devait y mourir. »
L’image du berceau est remplacée par le verbe « naître » (« Mankind was born on Earth »), mais le sens de la métaphore reste bien présent tandis qu’une justification écologique est ajoutée, en écho aux considérations de l’époque. Avec cette paraphrase, c’est davantage un sursaut de conservation de l’humanité que l’idée originelle de son émancipation par l’accès à l’espace qui est mise en avant.
Dans le film Passengers (2016), le mot « berceau » est investi du même imaginaire de l’aventure spatiale : quitter la Terre permettrait de sauver l’humanité. Toutefois, des enjeux économiques s’y ajoutent de façon à souligner la dimension astrocapitaliste d’un tel projet d’exode. En guise d’« introduction à la vie coloniale », un hologramme explique au personnage principal :
« La Terre est une planète prospère, le berceau de la civilisation (« the cradle of civilization »). Mais pour beaucoup, elle est aussi surpeuplée, surtaxée, surfaite (« overpopulated, overpriced, overrated »). »
La Terre est ainsi envisagée comme une marchandise par la compagnie privée qui possède le vaisseau. Son fond de commerce n’est pas la survie de l’humanité, mais l’exode vers une planète B édenique à bord de vaisseaux de croisière.
Le nom de Tsiolkovski s’efface dans ces deux films, et avec lui le lien syntaxique entre « Terre » et « berceau » grâce au verbe « être ». Le mot « berceau » devient dès lors un symbole. Sa seule mention dans un contexte astroculturel suffit à évoquer la Terre, et à ouvrir la voie à tous les espoirs d’une vie plus agréable, plus libre et plus abondante sur une autre planète.
Du berceau au foyer
L’imaginaire spatial apparaît aujourd’hui comme un champ de bataille culturel au sein duquel s’opposent diverses représentations de l’aventure spatiale. Aux récits les plus traditionnels – les rêves de conquête et d’utopie spatiales – s’opposent des récits dans lesquels les humains renoncent à la colonisation spatiale comme la publicité satirique de l’association Fridays for Future à propos de l’élitisme de la colonisation spatiale. Elle s’oppose, entre autres, au slogan « Occupy Mars » de SpaceX, l’entreprise astronautique d’Elon Musk, en détournant les codes de leurs supports de communication.
On peut trouver des récits similaires dans la SF, comme la bande dessinée Shangri-La (2016), de Mathieu Bablet, ou le roman l’Incivilité des fantômes (2019), de Rivers Solomon, qui extrapolent les racines capitalistes et colonialistes du rêve d’exode dans l’espace.
À l’interstice de ces deux pôles se trouvent des récits cherchant le pas de côté pour continuer à rêver de voyages spatiaux sans succomber à un récit dominant.
La critique du récit spatial dominant passe fréquemment par l’étude de sa réappropriation du mythe américain de la frontière (la Frontier, le front pionnier de la conquête de l’Ouest), de ses aspects militaires ou de sa dimension astrocapitaliste.
La métaphore du berceau reste trop souvent évacuée lorsqu’il est question de changer nos représentations de l’espace. S’il faut « cesser de parler de l’espace comme d’une frontière », comme l’appelle de ses vœux l’anthropologue Lisa Messeri, sans doute faut-il tout autant cesser de considérer la Terre comme un berceau. Mieux vaudrait la considérer comme un foyer, sans tomber dans la naïveté de croire qu’une telle reformulation permettrait de sortir du paradigme astrocapitaliste.
La stratégie de communication de Blue Origin – entreprise spatiale créée par Jeff Bezos – accapare déjà l’image du foyer pour se différencier de son concurrent SpaceX. Leur slogan tente de nous en convaincre : Blue Origin réalise ses projets spatiaux « pour le bénéfice de la Terre ».
Au moins certaines œuvres permettent un peu de respiration face à cette opération de récupération de la critique inhérente au « nouvel esprit du capitalisme ». À l’instar du roman Aurora (2015), de Kim Stanley Robinson, le Roman de Jeanne (2018), de Lidia Yuknavitch, Apprendre si par bonheur (2019), de Becky Chambers et le film Wall-E (2008), d’Andrew Stanton, sont des œuvres qui expérimentent, dans le fond et dans la forme, un double changement discursif : l’espace y devient au mieux un milieu à explorer avec humilité, au pire un lieu auquel l’humain renonce, mais il n’est plus une frontière à conquérir ; la Terre y est un foyer que l’on retrouve après des années d’absence et que l’on entretient du mieux possible, mais jamais un berceau que l’on veut à tout prix quitter.
L’auteur remercie Célia Mugnier pour son aide sur la traduction de la métaphore du berceau.![]()
Gatien Gambin, Doctorant en Études Culturelles / ATER en BUT Métiers du Multimédia et de l’Internet, Université de Lorraine
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.