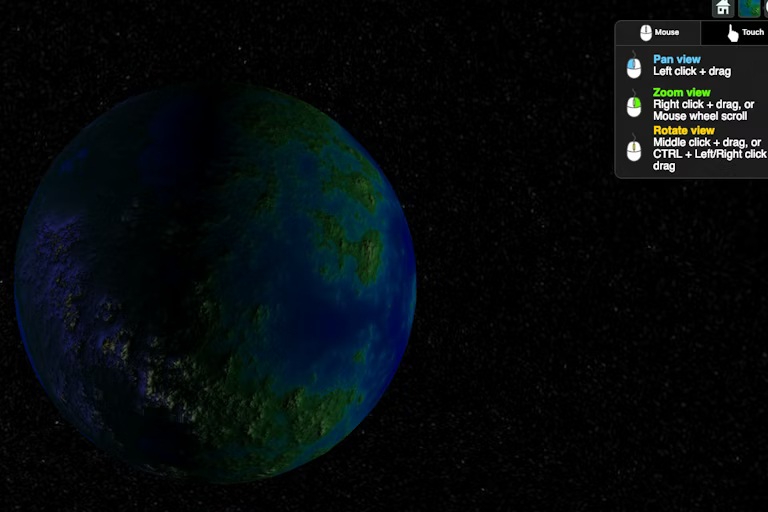Universités américaines : l’internationalisation devient-elle une ligne de défense ?
Ouvrir des campus à l’étranger peut-il devenir une stratégie pour les universités américaines désireuses d’échapper aux pressions politiques du locataire de la Maison Blanche ? Pas si sûr… Coûts cachés, standards académiques difficiles à maintenir, instabilité des pays hôtes : ces implantations sont bien plus fragiles qu’elles n’en ont l’air – et parfois tout simplement intenables.
Sous la pression croissante de l’administration Trump, certaines grandes universités américaines repensent leur stratégie internationale. Quand Columbia University (New York) accepte en juillet 2025 de modifier sa gouvernance interne, son code disciplinaire et sa définition de l’antisémitisme dans le cadre d’un accord extrajudiciaire, sans décision de justice ni loi votée, c’est bien plus qu’un règlement de litige. C’est un précédent politique. L’université new-yorkaise entérine ainsi un mode d’intervention directe de l’exécutif fédéral, hors du cadre parlementaire, qui entame l’autonomie universitaire sous couvert de rétablir l’ordre public sur le campus, en acceptant par exemple l’ingérence des forces de l’ordre fédérales pour le contrôle des étudiants internationaux.
Le même type de menace vise Harvard depuis quelque temps : restriction des visas étudiants internationaux, blocage potentiel de financements fédéraux, suspicion d’inaction face aux mobilisations étudiantes. Dans les deux cas, les plus éclatants et les plus médiatisés, l’administration fédérale a agi sans légiférer. Cette méthode « ouvre la voie à une pression accrue du gouvernement fédéral sur les universités », créant un précédent que d’autres établissements pourraient se sentir obligés de suivre.
Un redéploiement partiel à l’étranger
Un tel brouillage des repères juridiques transforme en profondeur un système universitaire que l’on croyait solide et protégé : celui des grandes institutions de recherche américaines. Désormais confrontées à une instabilité structurelle, ces universités envisagent une option qui aurait semblé incongrue il y a encore peu : se redéployer partiellement hors des États-Unis, moins par ambition conquérante que par volonté de sauvegarde.
Dans cette perspective, le transfert partiel à l’étranger, tactique pour certains, prémices d’une nouvelle stratégie pour d’autres, tranche par rapport aux dynamiques d’internationalisation des décennies passées. Georgetown vient de prolonger pour dix ans supplémentaires son implantation à Doha ; l’Illinois Institute of Technology prépare l’ouverture d’une antenne à Mumbai. Jadis portés par une ambition d’expansion, ces projets prennent aujourd’hui une tournure plus défensive. Il ne s’agit plus de croître, mais d’assurer la continuité d’un espace académique et scientifique stable, affranchi de l’arbitraire politique intérieur.
Pour autant, l’histoire récente invite à relativiser cette stratégie. Le Royaume-Uni post-Brexit n’a pas vu ses universités créer massivement des campus continentaux. Dans un contexte certes différent, la London School of Economics, pourtant pionnière en matière d’internationalisation, a renforcé ses partenariats institutionnels et doubles diplômes en France, mais a écarté le projet d’une implantation offshore. Les universités britanniques ont préféré affermir des réseaux existants plutôt que de déployer des structures entières à l’étranger, sans doute conscientes que l’université ne se déplace pas comme une entreprise.
La France en tête avec 122 campus à l’étranger
Les campus internationaux sont souvent coûteux, dépendants, fragiles. Le rapport Global Geographies of Offshore Campuses recense en 2020 bien 487 implantations d’établissements d’enseignement supérieur hors de leur pays d’origine. La France est en tête avec 122 campus à l’étranger, suivie par les États-Unis (105) et le Royaume-Uni (73).
Les principales zones d’accueil sont concentrées au Moyen-Orient et en Asie : les Émirats arabes unis (33 campus dont 29 à Dubaï), Singapour (19), la Malaisie (17), Doha (12) et surtout la Chine (67) figurent parmi les hubs les plus actifs. Pour le pays hôte, ces implantations s’inscrivent dans des stratégies nationales d’attractivité académique et de montée en gamme dans l’enseignement supérieur. Leur succès s’explique moins par des garanties de liberté académique que par des incitations économiques, fiscales et logistiques ciblées, ainsi que par la volonté des gouvernements locaux de positionner leur territoire comme pôle éducatif régional.
Le Golfe offre un contraste saisissant. Depuis plus de vingt ans, les Émirats arabes unis et le Qatar attirent des institutions prestigieuses : New York University (NYU), HEC, Cornell, Georgetown. Ces campus sont les produits d’une politique d’attractivité académique volontariste, soutenue par des États riches cherchant à importer du capital scientifique et symbolique. L’Arabie saoudite emboîte désormais le pas, avec l’annonce de l’ouverture du premier campus étranger d’une université américaine (University of New Haven) à Riyad d’ici 2026, visant 13 000 étudiants à l’horizon 2033.
En Asie du Nord-Est, aucun pays – Chine, Hongkong, Japon, Corée du Sud, Singapour – n’a envisagé d’accueillir un campus américain en réponse aux tensions récentes. En revanche, plusieurs cherchent à attirer les étudiants et doctorants affectés, notamment ceux de Harvard.
À Hongkong, des universités comme HKUST ou City University ont mis en place des procédures d’admission accélérées et assouplies. Tokyo, Kyoto ou Osaka proposent des bourses et exonérations de frais. Ces initiatives, qui relèvent d’une stratégie de substitution, s’appuient sur deux facteurs structurels : un investissement public soutenu dans l’enseignement supérieur et la présence d’un vivier scientifique asiatique considérable dans les universités américaines, facilitant les transferts. À ce titre, l’Asie-Pacifique apparaît aujourd’hui comme l’un des principaux bénéficiaires potentiels du climat d’incertitude politique aux États-Unis.
Aux États-Unis, le signe d’un basculement discret
La carte des campus offshore révèle un paradoxe historique. Jusqu’à récemment, les universités du Nord global ouvraient des campus dans des pays où la liberté académique n’était pas nécessairement mieux garantie (Singapour, Émirats arabes unis, Malaisie, Chine, Qatar…), mais où elles trouvaient stabilité administrative, incitations financières et accès à des étudiants de la région. Il s’agissait d’une stratégie d’expansion, pas d’un repli, comme aujourd’hui, face à une incertitude politique croissante.
L’idée reste encore marginale, émise à voix basse dans quelques cercles dirigeants. Mais elle suffit à signaler un basculement discret : celui d’une institution qui commence à regarder au-delà de ses murs, moins par ambition que par inquiétude. Or, l’international n’est ni un sanctuaire ni un espace neutre : traversé par des souverainetés, des règles et des normes, il peut exposer à d’autres contraintes.
La Sorbonne Abu Dhabi, inaugurée en 2006, relève d’une logique inverse : une université française établie dans l’espace du Golfe, à l’invitation du gouvernement d’Abu Dhabi, dans un cadre contractuel et de coopération bilatéral qui réaffirme, dans la durée, la capacité de projection mondiale d’un modèle académique national. Cette initiative ne visait pas la protection d’un espace académique menacé : elle cristallisait au contraire une stratégie d’influence assumée, dans un environnement institutionnel contrôlé.
Rien de tel dans les réflexions américaines actuelles où la logique d’évitement domine. Pourtant, les impasses du redéploiement sont déjà bien connues.
Des implantations fragiles
Les campus délocalisés à l’étranger souffrent d’une faible productivité scientifique, d’une intégration académique partielle et de formes de désaffiliation identitaire chez les enseignants expatriés.
Philip G. Altbach, figure incontournable parmi les experts de l’enseignement supérieur transnational, pointe depuis longtemps la fragilité des modèles délocalisés ; l’expert britannique Nigel Healey a identifié des problèmes de gouvernance, d’adaptation institutionnelle et d’intégration des enseignants. L’exemple plus récent de l’Inde montre que nombre de campus étrangers peinent à dépasser le statut de vitrines, sans réelle contribution durable à la vie académique locale ni stratégie pédagogique solide.
À ces limites structurelles s’ajoute une question peu abordée ouvertement, mais décisive : qui paierait pour ces nouveaux campus délocalisés hors des États-Unis ? Un nouveau campus international représente un investissement considérable, qu’il s’agisse de bâtiments, de systèmes d’information, de ressources humaines ou d’accréditations. L’installation d’un site pérenne exige plusieurs centaines de millions de dollars, sans compter les coûts d’exploitation. Or, dans un contexte de tension budgétaire croissante, de baisse des investissements publics dans l’enseignement supérieur et de reterritorialisation des financements, il n’est pas aisé d’identifier les acteurs – qu’ils soient publics, philanthropiques ou privés – qui seraient prêts à soutenir des universités américaines hors de leur écosystème.
Lorsque NYU s’installe à Abu Dhabi ou Cornell à Doha, c’est avec le soutien massif d’un État hôte. Cette dépendance financière n’est pas sans conséquence. Elle expose à de nouvelles contraintes, souvent plus implicites, mais tout aussi efficaces : contrôle des contenus enseignés, orientation scientifique, sélection conjointe des enseignants, autocensure sur certains sujets sensibles. En d’autres termes, vouloir échapper à une pression politique par l’exil peut parfois exposer à une autre. La liberté académique déplacée n’est qu’un mirage, si elle repose sur un modèle de financement aussi précaire que politiquement conditionné.
Mobilité académique et liberté de recherche
Dans un rapport récent du Centre for Global Higher Education, le sociologue Simon Marginson met en garde contre une lecture trop instrumentale de la mobilité académique. Ce ne sont pas les emplacements, mais les contextes politiques, sociaux et culturels qui garantissent ou fragilisent la liberté universitaire. Le risque majeur est la dissolution du cadre démocratique qui permet encore à l’université de penser, de chercher et d’enseigner librement.
Face à ce déplacement des lignes, l’ouverture d’un campus à l’étranger ne peut être qu’un geste provisoire, une tentative incertaine dans un monde déjà traversé par d’autres formes d’instabilité.
Ce que l’enseignement supérieur affronte aujourd’hui, ce n’est pas seulement la menace d’un pouvoir politique national, mais la fragilisation de l’espace où peut encore s’exercer une pensée critique et partagée. Certains observateurs, comme l’historien Rashid Khalidi, y voient le signe d’un basculement plus profond : celui d’universités qui, cédant à la pression politique, deviennent des « lieux de peur », où la parole est désormais conditionnée par le pouvoir disciplinaire.
Le défi n’est pas seulement de préserver une liberté. C’est de maintenir une capacité d’agir intellectuellement, collectivement, au sein d’un monde qui en restreint les conditions.![]()
Alessia Lefébure, Sociologue, membre de l’UMR Arènes (CNRS, EHESP), École des hautes études en santé publique (EHESP)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.