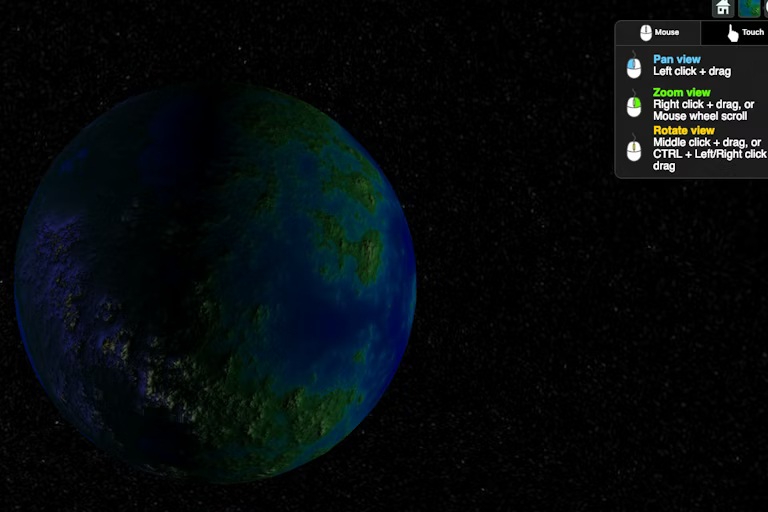Afghanistan : des mandats d’arrêt contre deux chefs talibans pour crimes contre l’humanité
Le 8 juillet 2025, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt contre deux dirigeants talibans, Haibatullah Akhundzada et Abdul Hakim Haqqani, pour persécution des femmes et des jeunes filles en raison de leur genre. Ces mandats, une première en la matière, marquent une étape inédite dans la reconnaissance des crimes commis par le régime taliban.
D’après la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale (CPI), il y a des motifs raisonnables de croire que le chef suprême Haibatullah Akhundzada et le chef de la justice Abdul Hakim Haqqani sont coupables d’avoir « ordonné, incité ou sollicité le crime contre l’humanité que constitue la persécution pour des motifs liés au genre ».
Les mandats d’arrêt – les premiers jamais délivrés pour des accusations de persécution fondées sur le genre – ont été salués comme une « importante revendication et reconnaissance des droits des femmes et des jeunes filles afghanes ».
Mais ces mesures amélioreront-elles réellement le sort des femmes et des jeunes filles en Afghanistan dans la mesure où les talibans ne reconnaissent ni le tribunal ni sa compétence ? Et qu’ils considèrent les mandats comme des « actes manifestements hostiles et comme une insulte aux croyances des musulmans du monde entier » ?
Les femmes sont effacées de la vie publique
Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les talibans ont imposé des règles et des interdictions strictes au peuple afghan. Les femmes et les jeunes filles sont écartées de l’espace public et subissent les pires traitements en raison de leur genre.
Selon les mandats d’arrêt, les talibans ont gravement privé, par le biais de décrets et d’édits, les filles et les femmes de leur droit à l’éducation, à la vie privée et à la vie familiale, ainsi que de leurs libertés de mouvement, d’expression, de pensée, de conscience et de religion. Les femmes sont interdites dans les lieux publics et les jeunes filles ne peuvent plus se rendre à l’école à partir de l’âge de 12 ans.
Zahra Nader est la rédactrice en chef du média Zan Times(« (le) Temps des femmes », en français, ndlr) qui enquête sur les violations des droits humains en Afghanistan. Elle affirme que les femmes et les jeunes filles afghanes sont réduites au silence, soumises à des restrictions et privées de leurs droits fondamentaux.
C’est ce système discriminatoire de contrôle des femmes en Afghanistan qui est au cœur des poursuites judiciaires.
Les mandats accusent également les talibans de persécuter les personnes qui ne se conforment pas à leurs attentes idéologiques en matière de genre, d’identité ou d’expression sexuelle, ainsi que les personnes perçues comme des « alliés des filles et des femmes », pour des raisons politiques.
C’est la première fois qu’une cour, ou qu’un tribunal international confirme l’existence de crimes contre l’humanité impliquant des victimes LGBTQIA+. Il s’agit d’une étape importante dans la protection des minorités sexuelles en vertu du droit international.
Des crimes contre l’humanité définis par le statut de Rome
Le droit international condamne clairement les infractions qui constituent des crimes contre l’humanité. L’objectif est de protéger les civils contre les atteintes graves et généralisées à leurs droits fondamentaux. Différentes définitions des crimes contre l’humanité ont été incluses dans les statuts des cours et des tribunaux internationaux.
La définition du statut de Rome de la Cour pénale internationale est la plus complète. Elle inclut la privation grave de liberté individuelle, le meurtre, la réduction en esclavage, le viol, la torture, la déportation forcée ou l’apartheid.
Plus précisément, les dirigeants talibans sont accusés en vertu de l’article 7, paragraphe 1, alinéa h du statut de Rome, qui stipule que :
« La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste […] ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international… »
La violence physique et directe n’est pas nécessaire pour que la persécution reposant sur des « motifs liés au sexe […] » soit établie. Pour cela, il faut s’appuyer sur des formes systémiques et institutionnalisées de préjudice, telles que l’imposition de normes sociales discriminatoires.
Les femmes et les jeunes filles sont souvent touchées de manière disproportionnée par les politiques et les règles des talibans. Mais il ne suffit pas de prouver que des crimes à caractère sexiste ont été commis. L’intention discriminatoire doit également être prise en compte.
Les talibans n’avaient pas caché leurs croyances et leurs interprétations religieuses, suggérant une intention claire de persécuter des personnes en raison de leur genre.
Une accusation uniquement symbolique ?
Comme dans d’autres affaires, la CPI compte sur la coopération des États pour exécuter et remettre les accusés.
Le gouvernement intérimaire de Kaboul, formé après l’invasion menée par les États-Unis en 2001, avait adhéré au statut de Rome en 2003. En conséquence, l’Afghanistan reste toujours légalement tenu de poursuivre les auteurs de ces crimes – et doit accepter la compétence de la Cour en la matière.
Le mouvement Purple Saturdays, un groupe de protestation dirigé par des femmes afghanes, a averti que les mandats d’arrêt doivent être plus que simplement symboliques. Tout échec dans les poursuites judiciaires risquerait d’entraîner une escalade des violations des droits humains. Les talibans ont toujours répondu à la pression internationale non pas par des réformes, mais en intensifiant leurs politiques répressives.
Une étape qui donne de l’espoir
Il est important de noter que les politiques strictes et les abus généralisés visant les femmes et les jeunes filles en Afghanistan se poursuivent, malgré l’intervention de la CPI.
Le Bureau du procureur de la Cour a affirmé son engagement dans la recherche « de voies juridiques efficaces » pour traduire en justice les dirigeants talibans. Les femmes afghanes en exil souhaitent la création d’un comité judiciaire international indépendant, chargé de surveiller et d’accélérer le processus judiciaire.
Le Bureau du procureur affirme, quant à lui, qu’il n’est pas encore certain que les mandats d’arrêt aboutiront à des arrestations et à des poursuites à La Haye. Mais nous savons que cela est possible. Un exemple frappant est l’arrestation, plus tôt cette année, de l’ancien président philippin Rodrigo Duterte. Par ailleurs, les mandats d’arrêt constituent déjà une avancée encourageante vers la responsabilisation des talibans et pour la justice pour les femmes d’Afghanistan.![]()
Yvonne Breitwieser-Faria, Lecturer in Criminal Law and International Law, Curtin University
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.